L'archive des Archives
- La rédaction
- 7 juin 2025
- 4 min de lecture
Il existe, à Carcassonne, un endroit hors du temps où l’on peut se perdre dans les savoirs les plus divers du territoire. Un temple silencieux où l’on vous aide à trouver par hasard ce que vous ne savez pas que vous cherchez.
Aux Archives Départementales Marcel Rainaud, toute la mémoire de l’Aude est rangée par époque, par thème, par auteur, par obsession ou par logique. À l’origine de chaque idée, de chaque récit, il y a un objet précieux : une feuille volante serrée dans une liasse, un journal, le chapitre d’un livre, une photo, un cahier ou un dessin : une archive !
C’est ce que nous allons vous proposer ici chaque mois. Tiré de ce coffre sans fond, une histoire de notre territoire, pour en savoir toujours davantage…

Pour commencer, et devant ce printemps qui passait des pluies diluviennes aux chaleurs étouffantes, nous avons voulu rendre hommage à un personnage attachant, enraciné dans la garrigue du pays de Lagrasse, curieux insatiable qui, à sa modeste place, a documenté son pays et ses passions. Henri-Jean Poudou, roi des apiculteurs de Corbières, nous a quitté depuis 17 ans déjà, mais tous ceux qui ont eu la chance de le croiser ne l’ont pas oublié. Henri-Jean Poudou était un érudit sauvage, un autodidacte qui a passé sa vie entière entre ses chères plantes de la garrigue et le moulin de Boysède, où il vécut avec ses parents et sa sœur.
Boysède dont, en 2006, deux ans avant sa mort, il racontait l’histoire dans la revue Le Monde des Moulins. Un beau texte, subtil, nostalgique et précis, comme il l’était lui-même…
« Dans les années 1870, le moulin de Boysède fut transformé de moulin farinier en usine à plâtre. En 1919, Eugène Poudou et son épouse Henriette Marty s’y installèrent pour construire des récepteurs radio pour capter les premières émissions de la Tour Eiffel sur Grandes Ondes (3000m).
En 1947, profitant de la riche flore des garrigues, des maquis des Corbières et de la proximité des Pyrénées, leurs enfants transforment le rucher familial en exploitation professionnelle. La transhumance des ruches permet d’obtenir des miels d’une variété exceptionnelle.Quant au moulin, il tourne toujours, grâce à sa turbine, pour la fabrication d’huile d’olive à l’échelle familiale et la production d’électricité. Pourtant il a subi bien des inondations. Le débit de ces rivières peut être multiplié par quatre-cent en quelques heures. En 1970, la crue atteignait sept mètres au moulin de Boyssède. Le 6 décembre 1996, il fallut déposer l’alternateur et l’amener à l’étage avec les objets précieux. Une montée de plus de deux mètres en dix minutes ne laissa pas le temps de déménager la miellerie et inonda les stocks de miel, les confiseries, le matériel d’extraction et deux véhicules. C’était la plus forte crue depuis 1891. La remise en état du moulin et de ses annexes s’est finalement réalisée au prix de soixante-dix jours de travail. Ces épisodes illustrent la violence et le danger des cours d’eau du versant méditerranéen. “Es pas temps qui ne tourne”, il n’est pas de situation qui ne revienne, ce qui n’empêche pas de profiter de cette charmante rivière peuplée d’excellents poissons et de “mitounes”, ces mystérieuses fées lavandières. »
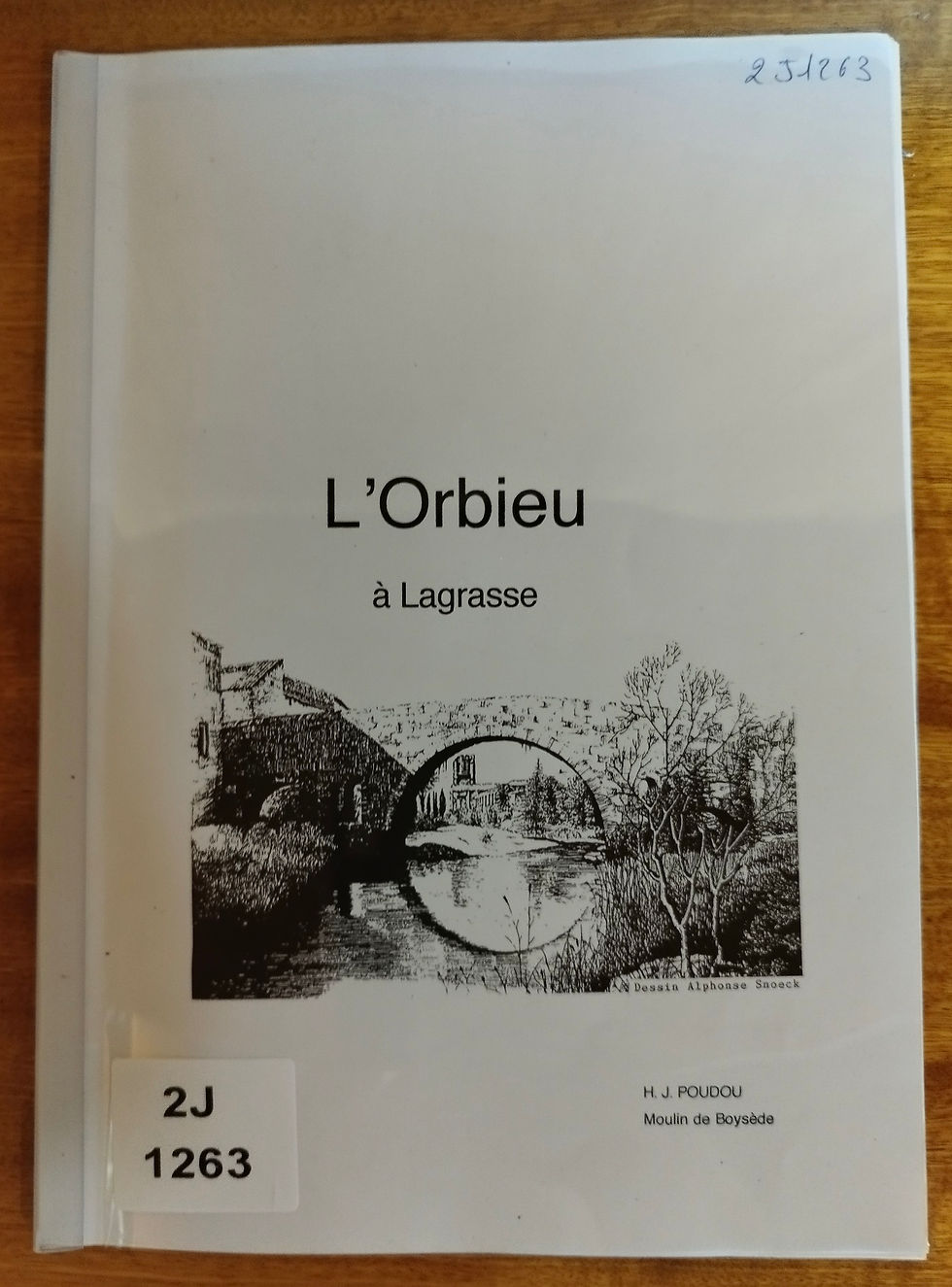
Sous la cote 2 J 1263, les Archives de l’Aude conservent aussi un petit cahier photocopié intitulé « L’Orbieu à Lagrasse », dans lequel Henri-Jean Poudou revenait en détail sur la dernière grande inondation qui a marqué Lagrasse et ses environs, celle des 12 et 13 novembre 1999, qui ont laissées derrière elles, dans le département de l’Aude, 25 morts et un disparu !…
« À Lagrasse, nous avons évité une catastrophe majeure, car si la perturbation, d’une telle ampleur, s’était trouvée centrée sur l’ensemble du bassin versant de l’Orbieu, la crue aurait dépassée toutes celles dont on garde la mémoire. »
Ce que l’on apprend, à la lecture de ce petit mémoire, qui s’appuie sur de nombreuses études officielles, c’est que les crues de l’Orbieu ont souvent, par le passé, provoqué des dégâts considérables et mis en péril les récoltes et les infrastructures des villages de notre territoire. Ainsi en 30 ans, de 1960 à 1990, on relève 26 crues, dont 20 de plus de trois mètres.
Et s’il n’y avait que les inondations !
« En Corbières, généralement vers la fin de l’hiver nous avons, avec une périodicité de cinq ans, des neiges importantes par perturbations orageuses d’est (entrées maritimes).
C’est ainsi que fin janvier 1986, nous avons eu des orages avec chutes de neige pendant une semaine : de 60 à 70 cm à Lagrasse, et 2 mètres en couche continue à Fourtou, Albières, au col du Paradis et dans les environs. »
Enfin, Henri-Jean Poudou, après avoir rassuré ses clients sur les dégâts subis après une énième crue : « Heureusement, la majeure partie de la récolte 96, ainsi que le nougat au miel ont échappé aux flots. », propose la reproduction d’un paragraphe d’un article de M. Pardé publié en 1938 par la Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, qui revient sur la terrible inondation de 1891 dans l’Aude…

La curiosité d’Henri-Jean Poudou allait bien au-delà des nuages et des précipitations. On consultera donc aussi avec profit les côtes 2 J 1260, où il élargit son propos à deux affluents de l’Orbieu, l’Alsou et la Madournelle, et Q°2759, où il conduit la visite des moulins à huile de la région au XIXe siècle…



Commentaires